|
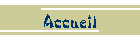













| |
 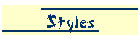    
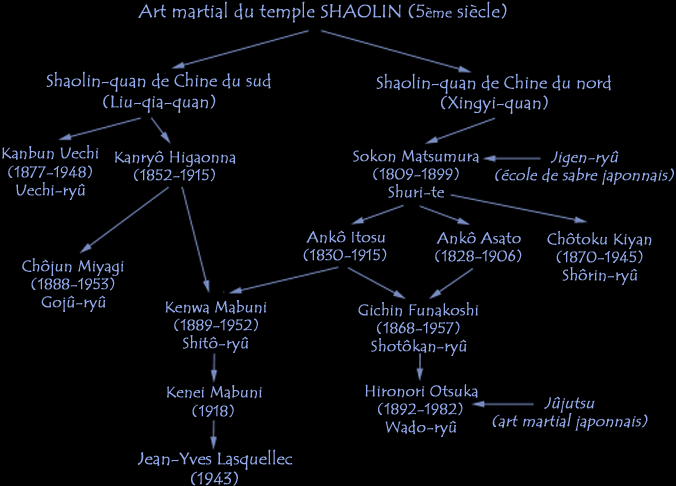
Les
quatre styles les plus représentatifs en France :

|
L'okinawaien
Gichin Funakoshi (1868-1957) (photo ci-contre) étudia l'Okinawa-Te avec
Anko Azato et Anko Itosu notamment et, en 1922, fut choisi pour
effectuer une démonstration à la première Exhibition Nationale Athlétique
à Tokyo. Le Karaté fut ainsi révélé au Japon tout entier. Devant le
succès de la démonstration, Funakoshi s'installa à Tokyo pour y
enseigner son style, rompant alors avec la tradition d'Okinawa pour
faire entrer sa méthode de Karaté-Do dans le cadre général des Budo.
A la fin des années 1930 sont créés l'organisation Shotokai et le
dojo Shotokan. Si Gichin Funakoshi pratiquait un Shotokan haut et court,
son fils Yoshitaka (mort en 1945) modifia sensiblement l'ensemble des
techniques du style, et enseigna un Shotokan plus bas et plus long
|
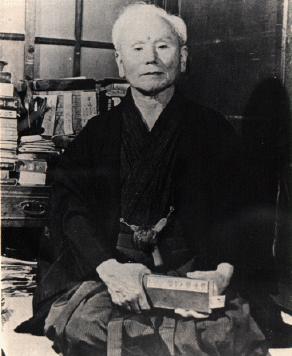
|
A
la mort de Funakoshi, le Shotokan se partagea entre plusieurs
associations, dont les plus importantes sont la Shotokai et la Nihon Karaté
Kyo Kai (Japan Karaté Association, créée en 1949 et remaniée en
1955). L'enseignement de Masatoshi Nakayama et Hidetaka Nishiyama,
rattachés à la JKA, s'éloigne de celui de Shigeru Egami, le chef
instructeur de la Shotokai.
Shigeru
Egami (1912-1981) créera son propre style, le Shotokai-Ryu, fortement
influencé par l'enseignement de Yoshitaka Funakoshi. Il crée de
nouvelles techniques, de nouvelles formes d'entraînement, remet en
cause certains fondamentaux du Karaté comme le tsuki, et renonce à
certains exercice tels que le travail au makiwara. Le Shotokai-Ryu est
un style très fluide, aux positions très basses. Une de ses caractéristiques
est l'aspiration à la réalisation du To-ate, c'est-à-dire la frappe
à distance.
|
RETOUR

|
Le Wado-Ryu ("école de la voie de la paix") est un
style japonais de Karaté qui fut fondé par Hironori Ohtsuka
(1892-1982) (photo ci-contre) à la fin des années 1930. Hironori
Ohtsuka, né à Shimodate City (préfecture d'Ibaragi) s'initie dès l'âge
de six ans au Jujitsu de l'école Shindo Yoshin Ryu, avec son père
Tokujiro Ohtsuka, puis en 1905 avec Nakayama Tatsusaburo, qui était également
expert en Kendo. Hironori Ohtsuka obtient un Menkyo Kaiden de cette école
en 1921. A cette époque, il a également l'occasion d'étudier le
Yoshin Koryu avec Kanaya Motoo.
|

|
Peu à peu va s'imposer dans l'esprit d'Ohtsuka l'idée d'adapter les
techniques d'atémi du Shindo Yoshin Ryu au Karaté de Funakoshi. Après
quatre ans d'études, il devient instructeur assistant de ce dernier
et parcourt avec lui le Japon pour promouvoir le Karaté, abandonnant
pour cela l'enseignement du Yoshin Shindo Ryu.
En 1924, les deux hommes se rendent à la salle d'entraînement au
Kendo de l'université Keio, et rencontrent Konishi Yasuhiro, le futur
fondateur du style de Karaté Shindo Jinen Ryu, qui y enseigne le
Kendo et le Jujitsu. Ils obtiennent de lui le droit de pratiquer le
Ryukyu Kempo To-te Jutsu, comme Funakoshi appelle alors son art, dans
cette salle.
Ohtsuka, qui a abandonné son emploi dans une banque de Shimodate pour
pratiquer la médecine traditionnelle comme son père, ouvre plusieurs
clubs à Tokyo dans les universités de Todai, Rikkyo et Nihon
notamment, et commence à élaborer dès 1929 une forme de Kumite
(combat libre) adaptée à la compétition, s'éloignant ainsi des méthodes
d'enseignement de Funakoshi. Il estime d'ailleurs que certaines
techniques des katas traditionnels ne sont pas adaptées au sparring,
et se met à intégrer au Karaté des éléments issus du Jujitsu et
du Kendo notamment. Il se livre ainsi à des expériences avec l'aide
de maîtres tels que le fondateur du Shito Ryu Kenwa Mabuni, le
pratiquant de Naha-Te Choki Motobu, le fondateur du Judo Jigoro Kano
ou encore celui de l'Aikido Morihei Ueshiba.
La séparation d'avec Funakoshi devient dès lors inévitable. Ohtsuka
officialise cet état de fait en inaugurant en 1934 sa propre école,
la Dai Nippon Karaté Shinko Club (qui deviendra en 1938 la Dai Nippon
Karatedo Shinbukai), ainsi que son style, qui est d'abord enregistré
sous le nom de Shin Shu Wado Ryu en 1938, puis de Wado Ryu en 1940
lors du 44e festival de Budo de Kyoto.
Après la Seconde Guerre Mondiale et la levée de l'interdiction en
1951 de la pratique des arts martiaux au Japon, la Zen Nippon Karate
Renmei ("Fédération de Karate de tout le Japon", qui reste
néanmoins une organisation privée de Wado Ryu) est créée. Le nom
Wadokai est enregistré en 1964 au sein de la Japan Karate Federation.
Les années qui suivent voient la diffusion du Wado Ryu en Europe et
aux USA notamment. Hironori Ohtsuka décède en janvier 1982.
A la mort d'Hironori Ohtsuka, le style s'est divisé en trois :
 |
Wado
Kai JKF : la branche des étudiants seniors d'Ohtsuka, qui perpétuent
l'enseignement de leur maître.
 |
Wado
Ryu Renmei : la branche du fils d'Ohtsuka, Jiro, qui fit sécession
avec la Wado Kai quelques mois avant la mort de son père.
 |
Wado
Kukosai WIKF : la branche de Tatsuo Suzuki.
|
| |
Le Wado Ryu est un style souple et fluide, aux postures relativement
hautes, où l'on cherche à esquiver l'adversaire et à retourner sa
force contre lui. Il n'existe donc pas d'exercices visant à renforcer
les armes naturelles.
Selon Jiro Ohtsuka, le Wado Ryu est avant tout une méthode de Ju
Jutsu, à laquelle furent ajoutées des techniques du Karate d'Okinawa
et les principes issus du Kendo et des écoles d'armes Yagyu Shinkage
Ryu et Toda. On utilise ainsi projections et clés, l'influence du
Kendo se faisant particulièrement sentir dans le Kihon Kumite et les
Tanto-Dori et Tachi-Dori.
Les principes du style sont Nagasu ("aspirer comme l'eau",
faire un pas de côté pour éviter une attaque), Inasu ("laisser
passer", bloquer et contrer dans le même temps), Noru
("enrouler", contrer au bon moment afin de porter à son
maximum la force générée par le mouvement en avant), Zanshin
(rester en éveil, attentif à son environnement), Yasume (être relâché,
sauf au moment de l'impact), Irimi (entrer dans l'adversaire), Mudana
no Waza (éliminer les mouvements superflus).
|
RETOUR

|
Le Goju-ryu est issu du Naha-Te, ou Shorei-Ryu, qui se divisait
autrefois en deux tendances : Ason et Waishingzan. La branche Ason s'est
éteinte. Waishingzan, un Okinawaien d'origine chinoise, eut pour élève
Kanryo Higaonna (1840 ou 1853 - 1915 ou 1916), qui avait auparavant étudié
le Shuri-Te avec Sokon Matsumura, puis, de 1870 à 1887, certains styles
chinois (Wing Chun, Tang Lang, Bai Hao, Tai Chi) sous la direction du maître
Woo Lu Chin du Fukien. De retour à Okinawa, il enseigne à Naha, et
donne à son style le nom de Naha-Te (qu'utilisait également Ason).
|

|
Kanryo Higaonna eut pour disciple interne Juhatsu Kyoda et pour
disciple externe Chojun Miyagi (1888 Naha - 1953), qui prit la
succession d'Higaonna en 1917, à son retour d'un voyage d'étude en
Chine. C'est Chojun Miyagi qui adopta en 1929 le mot Go-ju-Ryu ("école
de la force et de la souplesse") pour désigner son école. En
1952, il fonda l'association Goju-Ryu Shinko-Kai.
En 1932 Chojun Miyagi rencontra à Tokyo Gogen Yamagushi (1909-1989),
un pratiquant de Karate, qui devint son élève. Il en fit son représentant
unique pour le Japon, où Gogen Yamagushi fonda la Nihon Karate
Goju-Kai, la branche japonaise du Goju-Ryu. Chojun Miyagi témoigna
peu avant sa mort de l'apport considérable de Gogen Yamagushi au
Goju-Ryu, rôle dont certains maîtres okinawaiens ont par la suite
essayé de diminuer l'importance.
En 1953, Seikichi Toguchi, un élève de Chojun Miyagi, fonde à Koza
City le Shorei-Kan, au sein duquel il apporte des modifications
sensibles à la pratique du Goju-Ryu : il classifie les techniques,
les katas et les formes d'entraînement, crée de nouveaux katas, met
au point le Daruma-Taiso (exercice gymnique basé sur la respiration),
élabore de nouvelles formes de bunkai-kumite, intègre les katas exécutés
en musique, et teste un système de compétition utilisant des
protections anatomiques élaborées.
En 1957, Miyazato Eiichi, pratiquant de Judo et de Goju-Ryu sous la
tutelle de Miyagi Chojun, fonda à Naha son propre dojo, le Jundo-Kan
("Temple de la voie de la fidélité"), nom qui peut désigner
également la méthode-même qu'il y enseignait.
Le Goju-ryu est fortement influencé par les méthodes du sud de la
Chine : mêmes concepts techniques, même importance donnée au
travail de l'énergie interne. Les postures sont stables et puissantes
(sanchin dachi est la plus caractéristique du style), les coups de
pieds bas uniquement (essentiellement mae-geri et yoko-geri), la
respiration ventrale sonore, les déplacements courts et en
demi-cercles.
L'enseignement de Chojun Miyagi se divisait en quatre points
principaux :
 |
Tee
chikate mani : la pratique des katas classiques
 |
Kumite
: il n'y avait pas de combat libre, mais des applications à deux
d'un kata (bunkai kumite)
 |
Te
tochimani : exercices de combat pré-arrangés exécutés avec
partenaire
 |
Ikukumi
: combat entre deux élèves, où le plus gradé se contente de
bloquer ou d'esquiver sans contre-attaquer.
|
| | |
Les écoles okinawaiennes de Goju-Ryu enseignent la pratique du Kigu
hojo undo, un ensemble d'exercices de musculation spécifique exécutés
avec les instruments suivants : chishi (haltère court), kyukan (haltère
long), tetsuwa (deux petits anneaux de fer), kongoken (anneau de fer),
kami (jarre), sashi (pierre en cadenas).
|
RETOUR

|
L'école de Me kenwa Mabuni s'est structurée à partir des
enseignements de Maître Yasutsune ITOSU (1830-1915) qui habitait SHURI
et de Maître Kanryo HIGAONNA (1852-1915 ) qui habitait NAHA â OKINAWA.
Le nom d'école SHITO RYU vient de la réunion des 2 premiers caractères
: SHI vient de ITOSU, car peut être prononcé ITO. TO vient de HIGAONNA,
car peut être prononcé HIGA. Maître Kenwa MABUNI ne se contente pas
de juxtaposer 2 courants, mais il systématise les méthodes d'entraînements
avec un fondement rationnel et scientifique, nous rapporte son fils Maître
Kenei MABUNI dans son ouvrage "Karatédô shitô ryû ". Me
MABUNI Kenwa a eu pour élève : Maître TANI qui par la suite développa
sa propre branche, TANI HA SHITO RYU (Shukokai )
|

|
Maître Nakahashi, 8ème dan, explique les techniques du Shito ryu en
ces termes : « les caractéristiques techniques du Shito ryu
empruntent à la fois du Shuri-Té et du Naha-Té. Le style est marqué
par la subtilité (perception des attaques) et la vitesse. Les
techniques s’appuient sur la mobilité du bassin, les déplacements
du corps et la déviation des attaques. Le style est considéré comme
très esthétique tout en demeurant puissant » (Entretien dans Karaté
Bushido, avril 2000). Jean-Luc Clerget, 5ème dan et élève du Maître
ne le contredit pas lorsqu’il revient sur ces débuts après plus de
30 ans de pratique : « j’ai été séduit par l’esthétique de ce
style qui en plus propose une grande variété de techniques »
(ibid.).
Si l’aspect esthétique semble être une composante fondamentale du
style, ce n’est pas au détriment de l’efficacité :
- Les techniques sont en effet courtes, enroulées.
- Les déplacements en esquives sont systématiques pour sortir de la
ligne d’attaque.
- Les positions sont variées afin de respecter une distance optimale
par rapport à l’adversaire, et ce en fonction de l’action envisagée.
- Le principe « sen no sen », qui consiste en une « attaque dans
l’attaque » par anticipation de l’action adverse, est inclus dans
l’enseignement de manière très précoce.
Le Shito ryu est donc caractéristique d’un travail qui allie la
vitesse et l’esthétique technique. Celles-ci se réalisent dans une
très grande mobilité des hanches, dans les déplacements courts et
les blocages circulaires, avec les coudes près du corps.
Le fondateur du Shito ryu, Kenwa Mabuni avait énoncé cinq principes
fondamentaux, qui résument bien l’essence de son style :
- Le premier principe est « Ten I ». Il s’agit du travail de
placement, de manière à se retrouver dans l’angle mort de
l’adversaire afin qu’il soit dans l’impossibilité de voir venir
la contre-attaque, et de plus ne soit plus en mesure d’enchaîner.
- Le deuxième principe est « Rakka » : il consiste en l’action de
casser une attaque au seul moyen d’un blocage. Par exemple, un
blocage gedan baraï sur une attaque mae geri doit non seulement empêcher
la jambe adverse d’atteindre son corps, mais aussi de blesser
l’adversaire par le seul moyen du blocage afin qu’il ne soit au
moins assez déstabilisé pour ne plus pouvoir enchaîner les
attaques.
- Le troisième principe est « Ryushi » : il provient de
l’influence provennant de la boxe chinoise, par le biais de
l’enseignement de maître Higaonna. L’idée est basée sur la
notion de rythme, notamment pour s’adapter constamment à celui de
l’adversaire et utiliser sa force, comme en aïkido. Ici, la mobilité
du bassin va être utilisée de manière primordiale pour bloquer une
série d’attaques.
- Le quatrième principe est « Kushin » : on va s’appuyer sur le
travail des jambes, et principalement la flexion extension des genoux,
tout en gardant une rectitude vertébrale. L’efficacité des
blocages est alors augmentée car relayée par la puissance des
jambes.
- Le dernier principe est « Hangeki » : c’est la contre-attaque.
La défense est dans l’attaque et réciproquement. On rejoint là le
« sen no sen que nous évoquions plus avant : le blocage et la
contre-attaque sont effectués dans le même mouvement.
Bien entendu, ces principes ont été détaillé à des fins
d’explicitation mais se retrouvent liés dans l’épreuve du
combat…
|
RETOUR |
![]()
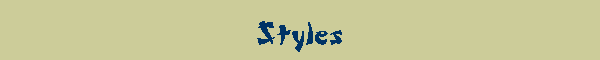
![]()